Deux lectures récentes m’ont intéressées quant à notre relation moderne avec le voyage. Pour le dire autrement, les codes inventés au 19ème sont encore vivaces aujourd’hui. Et ce qui surprend, c’est que finalement rien ne change. Les commentaires élogieux et les critiques à l’égard du tourisme portent sur des aspects similaires. Pour se mettre dans le bain, voici quelques citations d’auteurs et autrices qui plantent le décor de leurs perceptions du voyage.
- Flaubert : « Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule que l’on occupe dans le monde. »
- Baudelaire :
- « Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
- L’univers est égal à son vaste appétit.
- Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes !
- Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! »
- Henri Michaud : « Le monde devient cadastré », c’est-à-dire connu, mesuré, parfois vidé de son mystère.
- Barbara : Les voyages, magnifique chanson.
Ou encore Châteaubriand inventant l’expérience par le recours au « je » dans son récit De Paris à Jérusalem en…1811. Cette année est signalée comme étant en quelque sorte le point de départ du récit romantique du voyageur. Pour le dire autrement, à partir de ce moment-là, la personnalité du narrateur compte plus que la découverte générée par le voyage. La collusion avec le recours aux influenceurs et aux auteurs d’expériences d’aujourd’hui nous éclaire sur le fait que voilà déjà 200 ans, tout existait… Aujourd’hui n’est qu’une reproduction, certes habitée par nos outils modernes, le smartphone et ses fonctions multimedias et désormais l’IA en pointe.
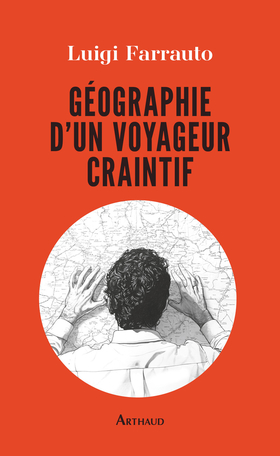
Géographie d’un voyageur craintif
Géographie d’un voyageur craintif est bien plus qu’un simple récit de voyage : c’est une œuvre hybride, à la croisée de la cartographie, de la littérature et de l’autofiction. Luigi Farrauto, docteur en design et passionné de cartes, y mêle récits, réflexions et représentations graphiques pour offrir une exploration aussi originale que décalée du voyage contemporain.
L’ouvrage s’articule autour de douze chapitres, chacun introduit par une carte du territoire concerné. Ces cartes ne sont pas de simples illustrations, mais des portes d’entrée dans des récits où l’aventure le dispute à l’introspection. Farrauto, à l’instar de Salvator dans Le Nom de la rose d’Umberto Eco, manie une langue composite – anglais, espagnol, français, italien – reflétant la diversité des lieux traversés et la richesse de ses influences. Ce mélange linguistique n’est pas anodin : il souligne la porosité des frontières, qu’elles soient géographiques ou culturelles, et invite le lecteur à une immersion totale dans l’univers de l’auteur.
Farrauto, en tant que créateur et interprète de mappemondes et de planisphères, joue avec les codes de la représentation spatiale. Rappelons que la mappemonde (du latin mappa mundi) désigne une carte représentant les deux hémisphères terrestres, tandis que le planisphère propose une projection plane de l’ensemble du globe. Cette distinction, loin d’être anecdotique, éclaire la démarche de l’auteur : ses récits, comme ses cartes, sont des constructions subjectives, où la précision géographique se teinte d’émotion et d’humour.
Ce qui frappe dans Géographie d’un voyageur craintif, c’est l’autodérision avec laquelle Farrauto assume ses peurs et ses doutes. Loin des clichés du voyageur intrépide, il se présente comme un antihéros, confronté à l’inconnu quotidien avec une lucidité désarmante. Ses aventures, souvent teintées d’absurde, oscillent entre solitude et rencontres, peur et amitié, vide et saturation. L’auteur transforme ses appréhensions en une force narrative, créant des parenthèses humoristiques qui désacralisent l’idée même du voyage. Le déplacement devient alors une métaphore de la vie, où les espaces-temps entre départ et arrivée sont autant d’opportunités de se réinventer.
Farrauto s’éloigne délibérément des poncifs touristiques – bienveillance systématique, surtourisme, écologie de façade – pour plonger le lecteur dans des aventures authentiques, parfois inconfortables. Son regard acéré et son style alerte rappellent ceux des grands écrivains-voyageurs comme Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Ella Maillart ou Bruce Chatwin, qui savaient allier récit personnel et réflexion universelle. En dressant, à la fin de l’ouvrage, un état des lieux des personnes rencontrées, il questionne la pérennité des liens créés en chemin et la trace laissée par ces rencontres éphémères.
A lire : Luigi Farrauto, Géographie d’un voyageur craintif, Arthaud.
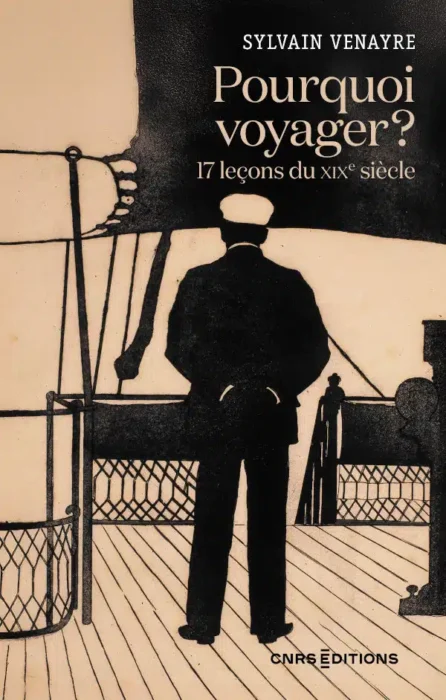
Pourquoi voyager ? 17 leçons du XIXème siècle
Le XIXème siècle a profondément marqué l’imaginaire du voyage, comme le souligne Sylvain Venayre, professeur d’histoire contemporaine et spécialiste de l’histoire culturelle du voyage. Cette époque, marquée par les révolutions industrielles, l’essor des transports et l’exploration coloniale, a posé les bases du voyage moderne. Nicolas Bouvier résumait cette fascination par une formule célèbre : « Le voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. »
Cet héritage, à la fois fascinant et ambigu, est au cœur de l’analyse de Sylvain Venayre. Le voyage devient une quête identitaire, une aventure littéraire et une expérience transformatrice, portée par des auteurs comme Chateaubriand, Flaubert, Gautier, Baudelaire, Verne ou Rimbaud. Ces écrivains ont façonné une culture du voyage mêlant littérature, science et imaginaire, souvent teintée de colonialisme et de romantisme.
Ainsi, De Paris à Jérusalem, est un récit de voyage publié en 1811 par Châteaubriand. Il adopte le « je », une nouveauté. Son texte est tissé de citations et de notes bibliographiques qui en font autant un récit de voyage géographique qu’une réflexion sur l’histoire et la littérature. Il couvre des temps immenses voyageant de la mythologie antique aux récits bibliques, de l’histoire grecque, romaine, égyptienne, byzantine et arabe jusqu’à la conquête de l’Égypte par Bonaparte, en passant par les Croisades. Homère, Tacite, Virgile, Plutarque, Bossuet, et bien d’autres sont cités, sans oublier Barthélemy et son Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Toutes ces références, des récits antiques jusqu’aux souvenirs de voyageurs du 18e siècle, lui servent de guide dans sa recherche des sites antiques et des monuments. Dans cet Itinéraire, Chateaubriand voyage autant dans des pays réels que dans des contrées imaginaires nées de ses lectures, de son imagination et de sa nostalgie du passé. Une forme de Corto Maltese d’il y a plus de deux siècles !
Ce XIXème siècle a vu naître de nouvelles modalités de déplacement :
- Pèlerinage, voyage savant, voyage d’agrément : le voyage n’est plus seulement utilitaire, mais il est aussi une quête de sens et d’exotisme.
- Le roman d’aventures et l’exotisme : le voyage devient un motif littéraire, souvent lié à la domination coloniale et à une vision idéalisée de l’ailleurs.
- Le tour, déjà exploré un siècle plus tôt, prend un nouvel essor.
- La littérature de science-fiction, largement promue par Jules Verne, conduit vers des horizons inattendus.
Sylvain Venayre rappelle que cette période a aussi vu l’émergence d’une tension entre voyage et tourisme, entre quête authentique et standardisation des pratiques. Celui qui n’est pas un voyageur, désintéressé, a été nommé touriste.
Dans Pourquoi voyager ?, Venayre propose une relecture critique de cet héritage. Il montre comment le voyage, loin d’être neutre, a été un outil de connaissance, de domination, mais aussi d’émancipation. Chaque leçon interroge la persistance des imaginaires du XIXe siècle :
- Le voyage comme miroir de soi : Lamartine disait « Un voyage est un regard écrit », soulignant la capacité du voyageur à transformer ses émotions en œuvre d’art.
- La mauvaise conscience du voyage : dès le XIXe siècle, le voyage est associé à une forme de culpabilité, notamment face à la colonisation et à l’uniformisation du monde. On croirait se retrouver dans notre époque quant au surtourisme, à l’impact environnemental et civisationnel du tourisme…
- Le voyage comme pratique critique : réinventer le voyage, en le libérant des clichés hérités du passé, pour en faire une expérience plus consciente et responsable.
Et bien d’autres sujets encore développés dans cet ouvrage documenté. Bref, une lecture passionnante.
A lire : Sylvain Venayre, Pourquoi voyager ? 17 leçons du XIXe siècle, CNRS Éditions, 2025.
J’aurais aussi voulu vous parler d’un ouvrage également remarquable écrit par Gilles Montègre et publié chez Tallandier : Voyager en Europe au temps des lumières, Les émotions de la liberté. Mais le temps de lecture m’a manqué (il me reste 300 pages à lire), ce sera peut-être pour une prochaine chronique. Je retiens juste ces deux phrases introductives, qui donnent le tempo de la suite, captivante : « L’essouflement du modèle touristique revêt (parallèlement) une dimension philosophique. A l’heure de la cannibalisation des lieux du voyage par les mêmes enseignes de grande consommation, de l’uniformisation des espaces de visite au prisme des labels patrimoniaux et de l’artificialisation des rencontres au gré du travestissement folklorique des populations autochtones, le dépaysement auquel aspirent les voyageurs est de moins en moins au rendez-vous ».

