2017 : parmi les différentes histoires d’offices de tourisme du futur présentés par la commission prospective d’OTF au congrés de Reims, on raconte cette fiction : « L’Office de Tourisme des Trois Vallées s’est transformé en coopérative… » Un office fondé sur une gouvernance multi-collèges, réunissant collectivités, entreprises touristiques, associations, habitants et salariés dans une structure coopérative. L’OT y était décrit comme un outil partagé, chargé d’animer l’écosystème local, de produire du commun, et de fonctionner selon les principes de l’ESS. Un modèle stimulant, mais qui était totalement théorique à l’époque.
2025 : L’Office métropolitain du tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg se transforme en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Un choix rare dans notre paysage institutionnel. Retour sur cette (r)évolution !
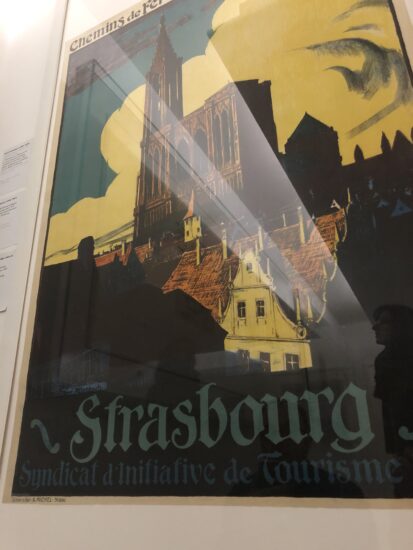
La SCIC, un modèle ancien mais sous-utilisé
Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif existent depuis 2001. Elles permettent de réunir au sein d’une même gouvernance des acteurs d’horizons différents, autour d’un projet d’utilité territoriale. Les principes de la SCIC sont forts :
– une finalité d’intérêt collectif, qui dépasse les seuls intérêts des sociétaires ; la SCIC porte une mission d’utilité publique territoriale ;
– la présence obligatoire de plusieurs catégories d’acteurs (au moins trois), là où une SCOP, par exemple, ne rassemble que les salariés associés ;
– un sociétariat ouvert : collectivités, entreprises, associations, habitants, salariés peuvent être membres simultanément ;
– un mode de gouvernance fondé sur les collèges, chacun disposant d’un poids défini dans les décisions stratégiques ;
– la règle coopérative de base : dans chaque collège, « un sociétaire = une voix », quelle que soit la taille économique de l’acteur ;
– l’encadrement strict de la lucrativité : les résultats sont majoritairement réinvestis dans le projet plutôt que distribués.
Longtemps associées aux tiers-lieux, à la culture, aux mobilités ou à l’ESS, les SCIC n’avaient à ma connaissance jamais existé pour un Office de Tourisme.
Strasbourg devient ainsi pionnière. Mais cette transformation n’arrive pas par hasard. Après la crise sanitaire, l’Eurométropole a redéfini sa stratégie autour de trois axes : diversification, durabilité, inclusivité. Sabine Brousse, directrice de l’Office métropolitain du tourisme, des loisirs et des congrès, rappelle : « La nouvelle mandature a travaillé sur une stratégie touristique, avec trois axes forts : une offre plus durable, plus diversifiée et plus inclusive ».
Le rapprochement entre tourisme de loisirs et tourisme d’affaires est devenu évident. La fusion-absorption du Convention Bureau par l’Office, effective le 1ᵉʳ juillet 2024, fut la première pierre. Le chantier de la gouvernance a suivi immédiatement.

La Fabrique de Destination, matrice du projet
Lancée au printemps 2024, la Fabrique de Destination a servi de laboratoire. Huit ateliers, deux conférences annuelles et près de 700 acteurs mobilisés ont permis de mettre en circulation les idées, de consolider les liens entre opérateurs et de dessiner une vision partagée. La Fabrique s’est vite imposée comme un espace d’expérimentation continue : chaque thématique a donné lieu à des groupes de travail ouverts, associant professionnels du tourisme, acteurs culturels, structures sociales, artisans, habitants engagés et partenaires institutionnels.
Les ateliers ont couvert un spectre large : valorisation de l’artisanat local, mobilisation autour du patrimoine, scénarisation de la dimension européenne de Strasbourg, tourisme durable, micro‑voyage, accueil des congressistes ou encore offres de loisirs de proximité. Certains se sont tenus le matin, d’autres en soirée, pour permettre à chacun de participer selon son rythme. Chaque séance s’est déroulée dans un lieu différent, souvent insolite, afin de révéler des endroits méconnus du territoire. Les participants sont repartis avec des informations actualisées, des contacts et parfois des pistes d’action à tester.
La Fabrique a aussi joué un rôle de diffusion des connaissances. L’Office et l’Eurométropole y ont présenté régulièrement des enquêtes, des retours d’expérience ou de nouveaux outils. Elle a animé le réseau en continu grâce à des rendez‑vous mensuels (ateliers, conférences, petits‑déjeuners de networking) et s’appuyait sur une agence spécialisée en intelligence collective pour structurer les échanges.
« La Fabrique, c’est une animation de l’écosystème », résume Sabine Brousse. Elle souligne que ce dispositif « permet à chacun, petit ou grand acteur, de contribuer à la construction de la destination ». L’expérience a donc rapidement démontré le besoin d’un outil institutionnel plus ouvert, plus démocratique et plus représentatif. Un choix encouragé par les élus de la métropole, qui a délibéré pour la transformation de l’Office de Tourisme en SCIC le 28 mars 2025
Une gouvernance beaucoup plus ouverte
La SCIC introduit une gouvernance allégée par rapport à l’ancien conseil d’administration de l’Office qui comptaire 40 membres. Ainsi, le conseil coopératif est composé de 20 membres uniquement, complété par un système de suppléants.
Côté composition, la SCIC compte 4 collèges : les socioprofessionnels (35% ), les partenaires (15%), l’Eurométropole (40%) et les % salariés (10%). La collectivité n’est donc pas majoritaire, et les autres collèges doivent faire des alliances. À ces pourcentages correspondent des délégations précises : neuf titulaires et neuf suppléants pour le collège des socioprofessionnels, cinq titulaires et cinq suppléants pour le collège des partenaires, cinq titulaires et cinq suppléants pour le collège de l’Eurométropole, enfin un titulaire et un suppléant pour le collège salarié.
Il est intéressant de regarder la composition de ces collèges :
- Le collège des socioprofessionnels se compose de deux sous‑catégories. Dans la partie « privée » (catégorie A), on retrouve les grandes têtes de réseau et les entreprises structurantes de la destination : UMIH, GNC, Batorama, les commerçants, ainsi que des tours‑opérateurs, agences événementielles, structures d’hébergement ou entreprises réceptives.
La partie « associative et ESS » (catégorie B) regroupe au contraire des organisations plus petites mais essentielles pour la vie locale : associations culturelles, clubs de randonnée comme le Club Vosgien, associations de guides conférenciers, structures d’insertion ou de loisirs de proximité engagées dans l’accueil, la médiation et l’hospitalité. Leur présence introduit une diversité de valeurs et de pratiques.
- Le collège des partenaires rassemble les chambres consulaires, l’ADT et l’ART Grand Est, l’aéroport, etc.
- Le collège de l’Eurométropole comprend les élus, tandis que le collège salarié — une première nationale — donne une voix directe à ceux qui bossent!
Si Strasbourg n’a pas voulu d’un EPIC ni d’une SPL classique mais d’une SCIC, c’est simple : associer durablement ceux qui construisent la destination.

Est-ce que ça marche?
Evidemment, m’a expliqué Sabine Brousse, « la mise en place est récente. Les premiers conseils coopératifs ont eu lieu à l’été et à l’automne. Les animations par collège doivent encore monter en puissance. La Fabrique de Destination joue, pour l’instant, un rôle d’armature« .
La structuration de l’équipe se poursuit encore, notamment autour de l’observation, domaine où l’Office souhaite intégrer davantage d’outils data et d’intelligence artificielle. Sabine y voit un enjeu stratégique majeur, notamment pour fournir une information utile aux acteurs du territoire.
S’il est donc un peu tôt pour tirer un bilan, j’y vois la marque d’une volonté d’associer bien plus largement ceux qui font le tourisme sur un territoire. Ce qui, en 2017, relevait de la prospective, pourrait bien avoir commencé à vivre concrètement dans l’Eurométropole alsacienne…

